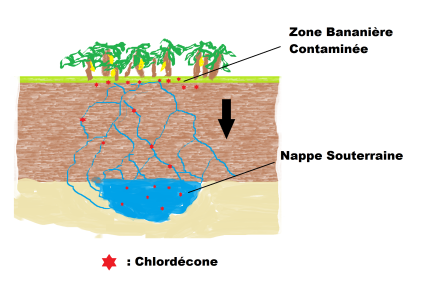Green Basics
La majorité des émissions récentes de CO2 sont imputables à 57 producteurs seulement
La grande majorité des émissions de dioxyde de carbone responsables du réchauffement de la planète depuis 2016 peut être attribuée ...
Des incendies de forêt records frappent le Venezuela en raison de la sécheresse qui sévit en Amazonie
Le Venezuela est confronté à un nombre record d’incendies de forêt, selon les dernières données publiées, alors qu’une sécheresse due ...
Vers une saison des ouragans extrêmement active en 2024 dans l’Atlantique
Les prévisionnistes de la Colorado State University (CSU) ont annoncé une saison 2024 « extrêmement active » pour les ouragans en Atlantique, ...
Les crédits d’émission de carbone séduisent les secteurs de la finance et de l’aviation
La demande de crédits reflétant l’élimination artificielle du dioxyde de carbone de l’atmosphère devrait, selon certains, exploser à mesure que ...
Selon la BERD, le scepticisme d’une transition écologique est plus important dans l’UE que chez ses voisins
Le scepticisme à l’égard du changement climatique et de la transition verte est plus important dans de nombreux pays membres ...
En Sicile, frappée par la sécheresse, « l’eau est de l’or »
L’île italienne de Sicile est confrontée à une grave sécheresse, le manque de précipitations hivernales ayant mis à rude épreuve ...
Opacité sur l’origine des ingrédients : Alerte de l’UFC-Que Choisir
Une étude de l’UFC-Que Choisir publiée jeudi 28 mars 2024, révèle que 69% des ingrédients des plats préparés manquent d’informations ...
Gaspillage alimentaire : Au moins 1 milliard de repas sont jetés chaque jour dans le monde
Chaque jour, un milliard de repas finissent à la poubelle dans le monde, un gaspillage alarmant selon un rapport publié ...
La montée des océans : un bond alarmant
Selon les dernières données de la NASA, la montée du niveau des océans a connu une augmentation significative entre 2022 ...
Rennes investit massivement pour électrifier son réseau de bus
Rennes Métropole s’engage résolument dans la transition énergétique en injectant 57,6 millions d’euros supplémentaires dans l’électrification de son réseau de ...
Le nucléaire de nouveau sur le devant de la scène poussé par Emmanuel Macron
Sous l’impulsion de la France et du président Emmanuel Macron, le nucléaire connaît un retour en grâce en Europe, se ...
Portrait : Merem Tahar, la voix de l’Afrique contre la désertification
A seulement 23 ans, Merem Tahar, militante écologiste française d’origine tchadienne, incarne la lutte contre la déforestation et la justice ...